Cathédrale Notre-Dame de Saint-Omer
« À la découverte d’un patrimoine remarquable »
…La Ville…
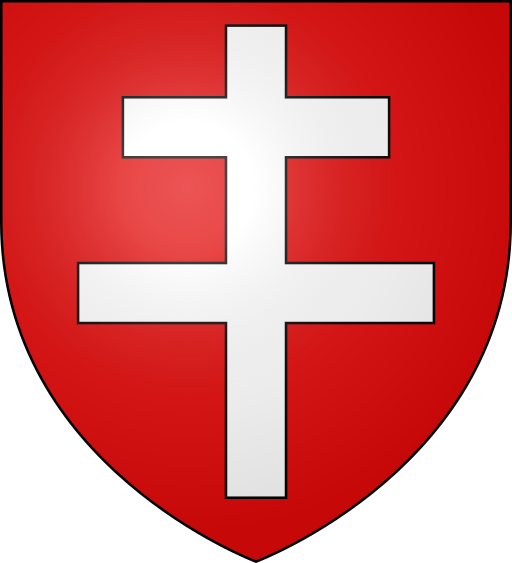
 Avec une population de 14 343 habitants en 2015, elle est la 12e ville du Pas-de-Calais. Elle est également la ville la plus peuplée de son aire urbaine qui est, avec ses 89 306 habitants, la 100e aire urbaine de France. Sa position géographique au centre de l’ancienne région Nord-Pas-de-Calais, à quasi-équidistance des grandes villes du littoral (Calais, Boulogne, Dunkerque) et des autres grandes villes du nord (Lille, Arras, etc.), lui confère une place relativement importante à l’échelle régionale. Elle fait partie du parc naturel régional des Caps et Marais d’Opale, et en est d’ailleurs la commune la plus peuplée. L’agriculture et la nature occupent une place importante sur le territoire avec le premier marais maraîcher de France, à l’hydrographie complexe, et des étangs classés en réserve naturelle nationale. Si la commune offre de nombreux commerces, loisirs et services, elle est fortement dépendante d’Arques et notamment de sa cristallerie Arc International, deuxième employeur privé régional. C’est également une ville au passé riche, ayant laissé de nombreux vestiges. Son patrimoine et sa proximité avec l’Angleterre, la Belgique et les Pays-Bas participent au tourisme local.
Avec une population de 14 343 habitants en 2015, elle est la 12e ville du Pas-de-Calais. Elle est également la ville la plus peuplée de son aire urbaine qui est, avec ses 89 306 habitants, la 100e aire urbaine de France. Sa position géographique au centre de l’ancienne région Nord-Pas-de-Calais, à quasi-équidistance des grandes villes du littoral (Calais, Boulogne, Dunkerque) et des autres grandes villes du nord (Lille, Arras, etc.), lui confère une place relativement importante à l’échelle régionale. Elle fait partie du parc naturel régional des Caps et Marais d’Opale, et en est d’ailleurs la commune la plus peuplée. L’agriculture et la nature occupent une place importante sur le territoire avec le premier marais maraîcher de France, à l’hydrographie complexe, et des étangs classés en réserve naturelle nationale. Si la commune offre de nombreux commerces, loisirs et services, elle est fortement dépendante d’Arques et notamment de sa cristallerie Arc International, deuxième employeur privé régional. C’est également une ville au passé riche, ayant laissé de nombreux vestiges. Son patrimoine et sa proximité avec l’Angleterre, la Belgique et les Pays-Bas participent au tourisme local.
…Son Histoire…
À l’époque de Charlemagne, lors de la dernière invasion marine due à une période de réchauffement climatique, Saint-Omer est un port[réf. souhaitée], alors que l’actuelle Flandre maritime est encore sous les eaux de la mer du Nord ainsi qu’une partie du Calaisis. Dans la 2e moitié du IXe siècle, Saint-Omer est ravagée par les Vikings du Danemark. Avec le pagus d’Artois, la ville entra en 932 dans la possession des comtes de Flandre, et au cours des xiie et xiiie siècles, l’industrie textile (protoindustrialisation ?) y fut florissante. Au cours de sa période de plus grande prospérité, la ville fut en Occident une des premières à bénéficier d’institutions communales, peut-être au début des années 1070 (Saint-Omer dispose d’un sceau dès 1050, le sceau étant un des attributs de la commune). Ces institutions prennent la suite d’institutions d’entraide de voisinage, formalisées sous forme de confrérie, qui évolue ensuite en guilde marchande, qui a donné naissance à la commune. Cette commune est un soutien pour le comte de Flandre qui lui a accordé ces libertés. Saint-Omer reçoit une charte communale qui confirme les anciennes libertés déjà accordées le 14 avril 1127 par Guillaume Cliton, Comte de Flandres. Par la suite, elle dut céder à Bruges la première place pour le tissage. L’Aa est canalisé dès 1165 jusqu’à Gravelines, qui constituera jusqu’à son ensablement l’avant-port de la cité audomaroise. La ville est assiégée en 1071.En 1096, Hugues de Saint-Omer participe à la première croisade. Son nom figure dans la cinquième salle des croisades du château de Versailles. Guillaume, châtelain de Saint-Omer, et son fils Oston, renouvellent entre les mains du patriarche de Jérusalem la donation des églises de Slype et Leffinge faite aux chevaliers du Temple. Jérusalem, 1137. Archives nationales de France. Aux XIe et XIIe siècles, les marchands de Saint-Omer sont organisés en guilde, dotée de statuts. Y sont codifiés, les beuveries mais aussi les conditions d’admission, le rôle des doyens, l’entraide, la charité envers les pauvres, l’entretien des places et des remparts, etc. Saint-Omer fut perdue par le comté de Flandre au traité de Pont-à-Vendin du 25 février 1212 et devint une des principales places du comté d’Artois qui venait de se créer. Ferrand de Flandre essaya de reprendre la ville mais il fut vaincu à la bataille de Bouvines. Dès lors la francisation commença et les documents officiels furent écrits en français ; le flamand n’en resta pas moins la langue courante dans la population et, au xiiie siècle, le chroniqueur Guillaume d’Andres nous affirme que, de son temps, les affaires se plaidaient en flamand. Encore en 1507 la coutume de Saint-Omer précise dans son article 7 que « ses majeurs et eschevins ont accoustumé faire raidigier leurs dictes sentences criminelles en langaige flamang ». La ville resta d’ailleurs dans une large mesure au sein du réseau économique des Pays-Bas dont elle était officiellement séparée. Vers l’an 1300 la ville compta près de quarante mille habitants. Le siège et la bataille de Saint-Omer ont lieu le 26 juillet 1340. En 1384, Saint-Omer revint aux ducs de Bourgogne, mais la paix de Nimègue (1678) la céda définitivement à la France. Les épidémies firent chuter le nombre d’habitants à quinze mille au XVe siècle.
La ville est assiégée en 1071.En 1096, Hugues de Saint-Omer participe à la première croisade. Son nom figure dans la cinquième salle des croisades du château de Versailles. Guillaume, châtelain de Saint-Omer, et son fils Oston, renouvellent entre les mains du patriarche de Jérusalem la donation des églises de Slype et Leffinge faite aux chevaliers du Temple. Jérusalem, 1137. Archives nationales de France. Aux XIe et XIIe siècles, les marchands de Saint-Omer sont organisés en guilde, dotée de statuts. Y sont codifiés, les beuveries mais aussi les conditions d’admission, le rôle des doyens, l’entraide, la charité envers les pauvres, l’entretien des places et des remparts, etc. Saint-Omer fut perdue par le comté de Flandre au traité de Pont-à-Vendin du 25 février 1212 et devint une des principales places du comté d’Artois qui venait de se créer. Ferrand de Flandre essaya de reprendre la ville mais il fut vaincu à la bataille de Bouvines. Dès lors la francisation commença et les documents officiels furent écrits en français ; le flamand n’en resta pas moins la langue courante dans la population et, au xiiie siècle, le chroniqueur Guillaume d’Andres nous affirme que, de son temps, les affaires se plaidaient en flamand. Encore en 1507 la coutume de Saint-Omer précise dans son article 7 que « ses majeurs et eschevins ont accoustumé faire raidigier leurs dictes sentences criminelles en langaige flamang ». La ville resta d’ailleurs dans une large mesure au sein du réseau économique des Pays-Bas dont elle était officiellement séparée. Vers l’an 1300 la ville compta près de quarante mille habitants. Le siège et la bataille de Saint-Omer ont lieu le 26 juillet 1340. En 1384, Saint-Omer revint aux ducs de Bourgogne, mais la paix de Nimègue (1678) la céda définitivement à la France. Les épidémies firent chuter le nombre d’habitants à quinze mille au XVe siècle. Ville économiquement prospère, Saint-Omer paraît également avoir été à la fin du Moyen Âge, entre la Flandre et l’Artois et Amiens, un centre artistique relativement important. Les chantiers de construction de la puissante abbaye Saint-Bertin et de la collégiale voient intervenir dès le XIIIe siècle des équipes d’artistes en provenance de Picardie et d’Île-de-FranceNote 1. Mais c’est au XVe siècle surtout, quand la région du Haut-Pays rentre en « terre de promission bourguignonne », que l’activité artistique y connaît ses plus belles heures. Entre 1454 et 1459, le célèbre Simon Marmion, originaire d’Amiens, y est de passage avant de rejoindre Valenciennes ; il peint, à la commande du puissant abbé Guillaume Fillastre, les volets du retable de l’abbaye Saint-Bertin, aujourd’hui à Berlin et à Londres, dont la huche orfévrée avait été réalisée par les Steclin, orfèvres valenciennois d’origine rhénaneNote. Par ailleurs, par ses lettres patentes, le roi Louis XI (1423-1483) confirma en septembre 1464 les privilèges de la ville, octroyées par ses prédécesseurs. En 1800, Saint-Omer était encore la ville la plus peuplée du département.
Ville économiquement prospère, Saint-Omer paraît également avoir été à la fin du Moyen Âge, entre la Flandre et l’Artois et Amiens, un centre artistique relativement important. Les chantiers de construction de la puissante abbaye Saint-Bertin et de la collégiale voient intervenir dès le XIIIe siècle des équipes d’artistes en provenance de Picardie et d’Île-de-FranceNote 1. Mais c’est au XVe siècle surtout, quand la région du Haut-Pays rentre en « terre de promission bourguignonne », que l’activité artistique y connaît ses plus belles heures. Entre 1454 et 1459, le célèbre Simon Marmion, originaire d’Amiens, y est de passage avant de rejoindre Valenciennes ; il peint, à la commande du puissant abbé Guillaume Fillastre, les volets du retable de l’abbaye Saint-Bertin, aujourd’hui à Berlin et à Londres, dont la huche orfévrée avait été réalisée par les Steclin, orfèvres valenciennois d’origine rhénaneNote. Par ailleurs, par ses lettres patentes, le roi Louis XI (1423-1483) confirma en septembre 1464 les privilèges de la ville, octroyées par ses prédécesseurs. En 1800, Saint-Omer était encore la ville la plus peuplée du département.
…Sa Cathédrale…
Modeste chapelle à l’origine, au viie siècle, on construisit une église sur le site aux environs de 1052 ; celle-ci fut endommagée vers 1200 par un incendie. On commença alors à reconstruire le chœur, le déambulatoire et les chapelles rayonnantes, puis en 1263, on construisit le transept. Les travaux ont avancé lentement et s’échelonnent du xiiie au xvie siècle. Bientôt l’église devint collégiale. Le croisillon sud du transept fut allongé en 1375 – 1379 et on entreprit alors la reconstruction de la nef. L’édification des chapelles latérales de la nef date des années 1386 à 1403. Les plus anciennes furent construites au sud. La nef centrale ne fut achevée qu’en 1473, et ses voûtes en 1506. De 1449 à 1472, Jehan de Meldre, maître d’œuvre procéda à l’allongement du croisillon nord du transept. À cette époque la tour à l’ouest qui était restée romane fut consolidée et rehaussée3. À partir de 1473 et jusqu’en 1521, on procéda à la construction de la tour occidentale autour de cette tour romane. Celle-ci fut ainsi rhabillée et reçut un décor inspiré de celui de l’abbatiale Saint-Bertin (construite entre 1431 et 1500). Les sculptures du portail occidental furent réalisées de 1511 à 1515, par les sculpteurs brugeois Jean et Josse Van der Poele. La flèche surmontant la croisée date de 1486. En 1553, la ville de Thérouanne toute proche, où se trouvait l’évêché de l’Artois, fut totalement rasée par les troupes de Charles Quint, au cours d’un conflit qui l’opposait au roi de France Henri II. Du sel fut symboliquement répandu sur le sol de la ville. Dans les années qui suivirent, il fut décidé de partager le diocèse de Thérouanne, afin de respecter les frontières entre le royaume de France et les Pays-Bas espagnols. Ainsi fut créé en 1559 le diocèse de Saint-Omer et la collégiale Notre-Dame devint cathédrale en 1561.En 1606, la flèche de la croisée fut détruite par un ouragan. En 1610, on réalisa le cadran solaire du portail sud, et en 1628, on procéda au renouvellement de la chapelle axiale que l’on nomme épiscopale et requise par le nouveau role d’évêché de St Omer mais qui endossa aussi le rôle de chapelle mariale bien plus tard.Le xviiie siècle apporta encore quelques embellissements : l’importante chaire, installée en 1714 en provenance de l’église des Dominicains de Saint-Omer, est due au sculpteur Danvin ; puis en 1717, fut installé le superbe buffet d’orgue des frères Piette, avec une remarquable statuaire en bois. Le trône épiscopal et les boiseries du chœur datent de 1753.En 1792, la cathédrale, fermée au culte, fut transformée en magasin à fourrage. Contrairement à bien d’autres églises, Notre-Dame n’eut que peu à souffrir du vandalisme des révolutionnaires. Par le concordat de 1801, le diocèse de Saint-Omer fut définitivement supprimé, au bénéfice du diocèse d’Arras. Redevenue simple église, Notre-Dame est néanmoins élevée au rang de basilique par le pape Léon XIII en 1879. Elle abrite à ce titre l’ombrellino basilical.
En 1553, la ville de Thérouanne toute proche, où se trouvait l’évêché de l’Artois, fut totalement rasée par les troupes de Charles Quint, au cours d’un conflit qui l’opposait au roi de France Henri II. Du sel fut symboliquement répandu sur le sol de la ville. Dans les années qui suivirent, il fut décidé de partager le diocèse de Thérouanne, afin de respecter les frontières entre le royaume de France et les Pays-Bas espagnols. Ainsi fut créé en 1559 le diocèse de Saint-Omer et la collégiale Notre-Dame devint cathédrale en 1561.En 1606, la flèche de la croisée fut détruite par un ouragan. En 1610, on réalisa le cadran solaire du portail sud, et en 1628, on procéda au renouvellement de la chapelle axiale que l’on nomme épiscopale et requise par le nouveau role d’évêché de St Omer mais qui endossa aussi le rôle de chapelle mariale bien plus tard.Le xviiie siècle apporta encore quelques embellissements : l’importante chaire, installée en 1714 en provenance de l’église des Dominicains de Saint-Omer, est due au sculpteur Danvin ; puis en 1717, fut installé le superbe buffet d’orgue des frères Piette, avec une remarquable statuaire en bois. Le trône épiscopal et les boiseries du chœur datent de 1753.En 1792, la cathédrale, fermée au culte, fut transformée en magasin à fourrage. Contrairement à bien d’autres églises, Notre-Dame n’eut que peu à souffrir du vandalisme des révolutionnaires. Par le concordat de 1801, le diocèse de Saint-Omer fut définitivement supprimé, au bénéfice du diocèse d’Arras. Redevenue simple église, Notre-Dame est néanmoins élevée au rang de basilique par le pape Léon XIII en 1879. Elle abrite à ce titre l’ombrellino basilical.
…La Montée…
La montée se fait directement dans la tour principale, un très long escalier de pierre en colimaçon nous achemine directement au niveau des cloches, et même jusqu’à la terrasse de la tour, d’où nous pouvons jouir d’une vue absolument remarquable sur Saint-Omer et ses alentours, selon certains dires, lorsque le temps est dégagé, nous pouvons voir la mer et même les côtes anglaises.
…L’histoire Des Cloches…
L‘histoire des cloches de la cathédrale de Saint-Omer débute en 1 470 c’est alors que 5 cloches logent dans la Tour Saint Bertin. En 1 586 une 6e cloche les rejoint. Aujourd’hui seule « Bertine » rescapée lors de la chute de la tour de Saint-Bertin en 1 947 sonne encore à Wisques. Ces six cloches exaspèrent les chanoines de la collégiale, qui veulent avoir de meilleurs cloches, c’est pourquoi le chapitre de la collégiale Notre-Dame Bénit 4 cloches en 1 475 « Omer », « Marie », « Austreberthe », « Madeleine ». En 1 474 Julienne avait été bénite mais non montée au Beffroi, une 6e cloche dite la « Bancloque » servait aux offices et aussi aux convocations des Audomarois pour les actes importants. La Révolution française va décréter qu’une seule cloche doit subsister par le clocher ou la ville. Les cloches de la cathédrale de Saint-Omer vont donc être en partie détruite comme bien dans bien d’autres clochers Audomarois, mais les révolutionnaires qui ont quand même protégé notre cathédrale, vont aussi faire une exception. Julienne sonna de 1 474 à 1 499 sur le beffroi provisoire sur la motte féodale avant d’être installée dans la cathédrale, ce sera la première cloche qui ne fut pas détruite en 1 792 par les révolutionnaires. Fêlée par des excès de ses sonneurs le 14 juillet 1 900, elle fit l’objet d’une tentative de réparation par brasage in situ en octobre 1 904, cette opération échoua.
…Présentation des Cloches…
Julienne, le Grand’Bourdon, fut refondu en 1 920 par la société Wauthy de Douai, elle et elle fut à l’arrêt faute de soins depuis 1 990, Le poids que j’ai estimé de ce Grand’Bourdon est de 5 520 kg (Poids dit dans les archives 5 300 kg) le mieux aurait été une pesée lors de la rénovation du beffroi. Il est intéressant de voir que les anciennes inscriptions de la première cloche sont encore gravées le long de l’épaule de la cloche. Le deuxième bourdon nommé Marie 1 fut fondu en 1 852 par le fondeur Petitfour, avec un diamètre de 169 cm et d’un poids de 2 950 kg, elle répond à sa grande sœur par un si bémol 2. La Cloche 3, nommée « Marie 2 », et une cloche qui a été fondue en 1 831, avec un poids de 990 kg et un diamètre qui est quant à lui de 123 cm, elle a comme note le Mibémol 3. La Cloche 4, appelée « Omer » mais aussi « Cloche de la retraite » a été fondue en 1 686, c’est la seule cloche classée au titre du « patrimoine historique », son poids est de 535 kg et son diamètre 99 cm, sa note est le Sol3. La Cloche 5, est appelée « Jeanne » ou encore « Jonatham » par ses paroissiens, cette cloche n’aurait pas été bénie d’où le fait qu’elle soit en fait dite « anonyme » et comme la société qui l’a fourni n’existe plus aujourd’hui, il est difficile de retracer son histoire, nous ne connaissons ni son nom, ni ses parrains marraines, ni son mode de de financement, ni même pourquoi elle a été mise dans le beffroi en 1933. Pourtant, le 9 septembre 1 933, un repas a eu lieu en l’honneur de Jonatham mais nous n’en trouvons aucune trace dans la presse de cette époque. C’est en 2017, lors de la rénovation complète du beffroi une 6e cloches fut ajoutée à l’ensemble, le nom qui lui a été choisi est « Domitille », elle fut coulée par la fonderie Eijsbouts à Asten (Pays-Bas) coût de l’opération 22000€. « Domitille » est la cloche la plus récente que j’ai eu la chance de photographier et de mettre en valeur (à ce jour (27/05/18)).. Elle fut fondue en 2 017 afin de respecter la tradition suivante: « Après de tels travaux sur un beffroi, la tradition veut qu’on y ajoute une cloche », deux possibilités avaient alors été évoquées, la fonte d’un Do3 de 2 354 kg, ce qui nécessiterait des modifications sur le beffroi d’avantage plus conséquents que l’autre option, qui fut la fonte d’un La3 de 482 kg
…Les Cloches…
…Cloche 1…
Nom: « Julienne », Diamètre 206,6 cm, Poids 5 520 kg, Fondue par Wauthy, à Douai, En 1 920, Chante le Lab2
…Cloche 2…
Nom: « Marie1 », Diamètre 169,0 cm, Poids 2 950 kg, Fondue par Petitfour à Arbot, en 1852, Chante le Sib2
…Cloche 3…
Nom: « Marie2 », Diamètre 123,0 cm, Poids 990 kg, Fondue par Gorlier, à Frévent, en 1 831, Chante le Mib3
…Cloche 4…
Nom: « Omer », Diamètre 99,0cm, Poids 535 kg, Fondue en 1 686, Chante le Sol3
…Cloche 5…
Nom: « Domitille », Diamètre 95,0 cm, Poids 452 kg, Fondue par Eijsbouts à Asten, en 2 017, Chante le La3
…Cloche 6…
Nom: « Jeanne », Diamètre 75,0 cm, Poids 250 kg, Fondue par Wauthy, à Douai, en 1 933, Chante le Si3
…Cloche 7 (Déposée)…
Cloche provenant de la chapelle Notre-Dame-Des-Miracles de Saint-Omer, détruite 5 ans avant avant la révolution Française, aux vues de ses formes, je peux aisément vous dire qu’elle est très ancienne, peut-être du XVIIe siècle. Une étude a été menée pour une possible intégration à la sonnerie actuelle, mais ne s’accordant pas avec les cloches, le projet fut laissé de coté.
…Carillon de 13 cloches…
Carillon fondue par le dénommé Paccard dans les années.
Ré4, Fa#4, Sol4, La4, Si4, Do5, Do#5, Ré5, Mi5, Fa#5, Sol5, Sol#5, La5
…Panorama sur Saint-Omer (Sommet de la tour-clocher)…
…La Vidéo…
…Piste audio…
…Mes Remerciements…
Je tiens à envoyer mes plus sincères remerciements à M.Delrue,Vice Président de l’association « Les amis de la cathédrale de Saint Omer », et Conservateur de l’horloge de cette même cathédrale, pour son accompagnement et la mise en volée exceptionnelle hors événements religieux de toutes les cloches. Je tiens également à le remercier pour la visite de la cathédrale, ainsi que pour les documents relatant l’histoire des cloches qu’il m’a fournie, j’ai pu, grâce à cela, effectuer un article complet.
Je remercie également M. Dépinois, pour sa bonne humeur et son accompagnement tout au long de cette découverte.
Enfin, je remercie Marine D. pour son accompagnement au clocher.
…Sources Textes…
Page Wikipédia De La Cathédrale De Saint-Omer
…Documentation…
« Pourquoi Une Sixième Cloche Du Plénum De La Cathédrale Notre-Dame-Des-Miracles-De-Saint-Omer » Edité par « Les Amis De La Cathédrale De Saint-Omer
Pour visionner les photos en très grande qualité, vous pouvez vous rendre sur l’album en lien —-> Cliquez <—-






















































